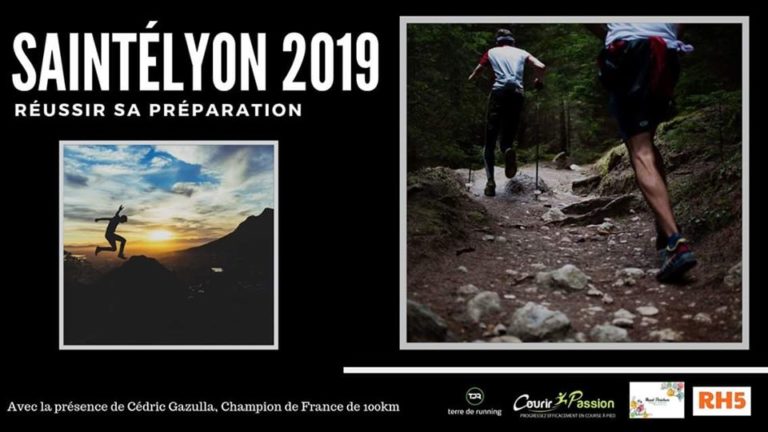LA NOUVEAUTÉ GARMIN ! La fēnix 6 Series est la nouvelle génération de montres connectées GPS haut de gamme. Inspirée des exploits des athlètes et des aventuriers, la fēnix 6 Series est destinée aux sportifs qui repoussent leurs limites et redéfinissent leurs objectifs. La fēnix 6 est une toute nouvelle conception, hautes performances, intégrant de nouvelles fonctionnalités de pointe, une bien meilleure autonomie et est proposée en plusieurs tailles et finitions, déclinées en séries 6/6S/6X. Cette nouveauté est plus qu’une simple montre GPS mUltisports. C’est un véritable objet connecté créés dans le but de relever tous les défis et de s’adapter à tous les styles de vie grâce, à des outils intégrés comme le moniteur de fréquence cardiaque au poignet, au Pulse Ox2, aux capteurs de navigation en plein air, aux profils d’activité intégrés, à une nouvelle fonctionnalité de gestion de l’énergie, aux statistiques de performance, au paiement sans contact, aux Smart Notifications4et bien plus encore. Optimisées pour l’Outdoor, les montres fēnix 6 Series Garmin sont disponibles avec des écrans antireflet actifs en permanence et des écrans plus grands pour faciliter votre utilisation et améliorer la visibilité. 1,2″ sur la fēnix 6S (soit 18 % plus grand que sur les précédents modèles de fēnix) 1,3″sur la fēnix 6 1,4″ sur la fēnix 6X (36 % plus grand que sur les précédents modèles de fēnix) Cette montre GPS Multisports est dotées de nouvelles fonctions tant pour votre pratique sportive que pour un usage quotidien. NOUVELLES FONCTIONS fēnix 6 ECRANS PLUS GRANDS VERRE À RECHARGE SOLAIRE POWER GLASS™ Les éditions fēnix 6X Pro Solar intègrent un verre à recharge solaire Power Glass sur leur écran de 1,4″ et utilisent l’énergie du soleil pour prolonger l’autonomie de la batterie et vous permettre de porter la montre plus longtemps pendant vos activités en plein air. EXTRÊMEMENT RÉSISTANTS Grâce à leur conception ultra-résistante, tous les modèles de fēnix sont testés conformément aux normes militaires américaines 810G de résistance à la chaleur, aux chocs et à l’eau. CARDIO AU POIGNET Le moniteur optique de fréquence cardiaque au poignet nouvelle génération évalue l’intensité de vos activités sportives ainsi que la variabilité de votre rythme cardiaque afin de calculer votre niveau de stress. Comprend les activités aquatiques. CAPTEUR PULSE OX Pour l’acclimatation à l’altitude ou surveiller votre sommeil, un capteur Pulse Ox2 utilise des faisceaux lumineux au niveau de votre poignet pour déterminer le niveau d’absorption de l’oxygène par votre corps. PACEPRO™ La toute première fonction PacePro vous permet de garder le rythme grâce à des conseils adaptés pendant que vous courez. Cette innovation permet de guider votre allure sur un parcours en prenant en compte son dénivelé en fonction d’un temps que vous vous êtes fixé. GESTIONNAIRE D’ÉNERGIE POWER MANAGEMENT Découvrez comment vos différents paramètres et capteurs ont un impact sur l’autonomie de votre montre afin de pouvoir apporter des modifications permettant en temps réel d’économiser de l’énergie MODE EXPÉDITION Voyagez sans limites. Le mode expédition, avec un GPS utilisant très peu d’énergie, dure plusieurs semaines. CARTES TOPO ET STATIONS / PISTES DE SKI Utilisez les cartes topographiques pour vous orienter pendant vos aventures et consultez le nom et le niveau de difficulté de 2 000 stations de ski du monde entier. STATISTIQUES DE PERFORMANCE Affichez des statistiques d’entraînement comme la dynamique de votre foulée, la VO2 max ajustée en fonction de la température et de l’altitude, une aide à la récupération et bien plus encore FONCTION TRENDLINE Utilisée pour le guidage pour que vous sortiez et couriez dans des endroits fréquentés par les habitants, elle est désormais disponible sous forme de carte superposable pour une meilleure orientation pendant vos activités. PARCOURS DE GOLF Accédez à des cartes CourseView (vue du parcours) en couleur pour plus de 41 000 parcours de golf du monde et profitez des données de distance par ciblage bouton et de la fonction PlaysLike Distance (calcul les distances en fonction du dénivelé du parcours). FONCTIONNALITÉS DE SUIVI ET DE SÉCURITÉ Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si votre montre détecte qu’un incident s’est produit, les fonctionnalités d’assistance et de détection d’incident envoient vos données de localisation à vos contacts d’urgence CONTRÔLEUR D’ÉNERGIE BODY BATTERY™ Optimisez les réserves d’énergie de votre corps grâce aux données de variabilité du rythme cardiaque, de stress, de sommeil et à d’autres données permettant d’évaluer quand vous pouvez passer à l’action ou devriez vous reposer. APPLICATIONS DE MUSIQUE Stockez jusqu’à 2 000 chansons ou accédez à des applications de musique en streaming via les services compatibles7, comme Spotify®, Deezer et Amazon Music, et écoutez votre musique avec des écouteurs dotés de la technologie BLUETOOTH® Récapitulatif des Fonctionnalités La nouvelle fénix 6 se décline également en version PRO / Sapphire et SOLAR. Ces modèles hauts de gamme à l’esthétique incomparable sont aussi dotés de fonctions dédiées : Verre Corning® Gorilla® Glass 3 (Éditions Pro uniquement) Verre saphir résistant aux rayures (Éditions Sapphire uniquement) Verre de recharge solaire Power Glass™ (Éditions Solar uniquement) Service Garmin Pay™ Gestionnaire d’énergie – Power Management Fonctionnalités de suivi et de sécurité Cartes des pistes de ski préchargées Fonctionnalité PacePro (Depuis Garmin Connect uniquement) Applications de musique préchargées (Spotify, Deezer, Amazon Music) Tarifs conseillés : de 599€ à 949€ selon les modèles. Découvrez la vidéo de présentation : Réservez dès à présent votre fēnix 6 séries GARMIN dans vos magasins Terre de Running ! La Fénix 6 sera disponible très prochainement.